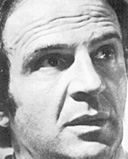La biographie de François Truffaut se confond très
tôt avec sa filmographie, avec ses films : sans être
à strictement parler autobiographiques, ses films,
au moins un certain nombre (Les Quatre Cents Coups et la
série des "Aventures d'Antoine Doinel"),
s'inspirent d'événements vécus ou d'obsessions
très personnelles, et, surtout, François Truffaut
se consacre entièrement, presque exclusivement, au
cinéma.
Tout commence avec la naissance, avec le secret de la naissance.
On sait que François Truffaut est né le 6
février 1932 à Paris, et qu'il est officiellement
le fils de Roland Truffaut, architecte-décorateur,
et de Jeanine de Montferrand, secrétaire à
L'Illustration. Ce que François Truffaut n'a appris
que tardivement, c'est que Roland Truffaut n'était
pas son véritable père. De cela, il ne parlera
pas publiquement, mais les traces subsistent. Il a raconté
que sa mère ne le supportait pas, qu'il devait se
faire oublier, rester sur une chaise à lire, qu'il
n'avait le droit ni de jouer, ni de faire du bruit. Souvent
confié à ses grands-mères, c'est d'elles
qu'il tient le goût, pour ne pas dire la passion,
de la lecture. Un véritable refuge pour un enfant
"pas aimé ou ignoré", n'ayant que
de rares mais très fidèles amis.
La lecture est un refuge, une passion qu'il conservera
toute sa vie. Adulte, son appartement et son bureau seront
remplis de livres, il gardera l'habitude d'en acheter beaucoup,
en plusieurs exemplaires, pour pouvoir les envoyer ou les
offrir à des amis. Il se passionnera également
pour l'édition, consacrant autant de temps à
son livre d'entretiens avec Alfred Hitchcock qu'à
un de ses films, rédigeant de nombreuses préfaces,
se faisant l'éditeur, par exemple, des oeuvres de
son père spirituel, André Bazin.
Le cinéma devient vite aussi important, sinon plus,
que la lecture, une "évasion encore plus forte".
Le premier souvenir de cinéma de François
Truffaut remonte au début de l'Occupation, quand
le cinéma était "devenu un refuge, et
pas seulement au sens figuré". Dès l'âge
de huit ans, le futur cinéaste de La Nuit américaine
commence à fréquanter les salles obscures,
d'abord avec ses parents, puis seul, et même en cachette.
Ses souvenirs d'école buissonière seront liés
au cinéma. Les Quatre Cent Coups donnent une assez
bonne idée de ce qu'a pu être l'adolescence
de Truffaut, avec une très mauvaise scolarité
et de rares amis : ceux qui partageaient ses fugues et ses
goûts pour les films réputés artistiques
ou difficiles. Dès 1945, à l'âge de
treize ans, il se forge ses propres opinions, ses propres
goûts, qu'il ne reniera jamais : Chaplin, Guitry,
Vigo, Cocteau, Renoir, Bresson, Welles, Hitchcock. Il devient
très vite ce que l'on appellera par la suite un "cinéphile",
voit et revoit les films, découpe des articles, fréquente
les ciné-clubs, en fonde un lui-même dans des
conditions rocambolesques. C'est ainsi qu'il rencontrera
André Bazin, qui deviendra le père qu'il aurait
voulu avoir, qui le sauvera de la (petite) délinquance,
qui le sortira de la prison militaire quand il sera porté
déserteur et qui le fera entrer aux Cahiers du cinéma
à partir de 1953.
François Truffaut a tout juste vingt ans quand il
devient un des "jeunes Turcs" de la critique française,
avec des amis qui ont nom Jacques Rivette, Claude Chabrol,
Jean-Luc Godard et Eric Rohmer. Ceux de la future "Nouvelle
Vague". Ensemble, ils prennent fait et cause pour des
cinéastes méconnus ou jugés uniquement
commerciaux, comme Alfred Hitchcock et Howard Hawks.
Ils se font partisans systématiques, volontiers
terroristes, de ce qu'ils appellent eux-mêmes la "politique
des auteurs". Pour toute la "bande des Cahiers",
la question ne se pose même pas : ils seront cinéastes
pour aller jusqu'au bout de leurs idées, de leur
conception du cinéma, très éloignée
des tendances, violemment condamnées, d'un "certain
cinéma français", dit "de qualité",
représenté par des hommes qui doivent leur
carrière à l'Occupation et qui ont le défaut
d'occuper le terrain et de réaliser des films loin
de la réalité, loin de la vie.
Réalisé en 1954, dans des conditions plus
que précaires, le premier court-métrage de
François Truffaut n'a qu'une valeur anecdotique :
Une visite n'a guère de scénario, est interprété
par des amateurs et, du propre aveu de son auteur, a comme
seul intérêt de lui montrer "ce qu'il
ne faut pas faire". Il ne le projettera qu'à
quelques amis. Quand il tournera Les Mistons, trois ans
plus tard, en 1957, il sera autrement maître de ses
moyens. Critique turbulent, mais en place, célèbre
et redouté pour ses prises de position catégoriques,
il a été à l'école d'un de ses
maîtres, Roberto Rossellini, et peut désormais
apprécier la distance qui sépare la critique,
étape nécessaire, de la mise en scène.
Les Mistons montreront de vrais amoureux (le couple ami
Bernadette Lafond-Gérard Blain) et de vrais enfants
filmés en décors réels (Nîmes
et la campagne environnante). Ce film court (23 mn) est
le véritable prélude de toute son oeuvre.
S'y manifestent déjà son intérêt
pour l'enfance et sa volonté de rester "très
près du documentaire". Enfin, François
Truffaut a créé sa propre structure de production,
Les Films du Carosse (en hommage au Carosse d'or, de Jean
Renoir, film particulièrement admiré), société
mise en place avec l'aide son beau-père, un important
distributeur de films unanimement respecté par la
profession : cette même année 1957, il épouse
Madeleine Morgenstern, qui lui donnera deux filles, Laura
et Ewa, nées respectivement en 1959 et 1961.
Tourné en un week-end, en 1958, pendant les inondations,
monté et commenté par Jean-Luc Godard, Histoire
d'eau n'est qu'une parenthèse légère
dans la filmographie de ses deux cosignataires. Il reste
surtout à Truffaut à réaliser son premier
long métrage. Ce sera évidemment un film sur
l'adolescence, en partie - mais en partie seulement - autobiographique
et interprété par un inconnu de quatorze ans,
Jean-Pierre Léaud, que l'on retrouvera dans le même
personnage d'Antoine Doinel tout au long de la filmographie
de l'auteur, à la fois double, alter ego et "fils
spirituel". Au même titre que Le beau Serge de
Claude Chabrol, d'A bout de souffle de Jean-Luc Godard,
de Paris nous appartient de Jacques Rivette ou du Signe
du Lion d'Eric Rohmer, Les Quatre Cents Coups peut être
considéré comme l'un des manifestes de cette
"Nouvelle Vague", qui prend alors le "pouvoir"
dans le cinéma français. Véritable
triomphe critique (cette année-là, c'est l'événement
du festival de Cannes) et public, Les Quatre Cents Coups
assoit définitivement la place de François
Truffaut. Ce succès a malheureusement été
assombri par la mort d'André Bazin, survenue le lendemain
du début du tournage. Mais l'essentiel est bien que
la "flamme", l'amour du cinéma, ait été
transmise.
La vie de Fançois Truffaut va se confondre dès
lors avec ses films. Le cinéma a la priorité
absolue, même si les week-end sont "sacrés"
et consacrés aux enfants et à la famille.
Truffaut ne cessera de tourner, ou presque, au rythme d'un
film par an. L'équilibre se constituera à
peu près entre scénarios originaux et adaptations
de livres aimés. Admirateur du cinéma américain,
François Truffaut réalisera plusieurs "séries
noires", d'après David Goodis, William Irish,
Henry Farrell et Charles Williams (rien que des classiques)
et fera même une incursion dans la science-fiction
avec Farenheit 541 (mais c'est aussi par amour des livres
puisque, dans le roman de Bradbury, il s'agit de les sauver
de ceux qui veulent les détruire...). Passionné
depuis toujours par l'oeuvre, alors méconnue, d'Henri-Pierre
Roché, il consacrera toute son énergie à
porter à l'écran Jules et Jim et Les Deux
Anglaises et le Continent, dont il reconstituera la version
définitive à la fin de sa vie, malgré
sa maladie. Il fera, à ses frais, établir
la monumentale dactylographie du journal intime de ce merveilleux
connaisseur de l'art moderne.
Les scénarios originaux, c'est d'abord la série
des Doinel (après Les Quatre Cents Coups : Antoine
et Colette, Baisers volés, Domicile conjugal, et
L'Amour en fuite), toujours avec Jean-Pierre Léaud,
qui sera également l'interprète des Deux Anglaises
et le Continent, de la Nuit américaine, et à
qui sera dédié L'Enfant sauvage. Ce sont des
films inspirés de faits divers, comme La Peau douce
(et même L'Enfant sauvage) ou d'expériences
personnelles (La Nuit américaine - le cinéma
! - et Le Dernier Métro - l'Occupation). Des films,
enfin, spécialement écrits pour des acteurs
: en dehors de Jean-Pierre Léaud, Jeanne Moreau,
Charles Denner (L'homme qui aimait les femmes), Bernadette
Lafont (Une belle fille comme moi) ou Fanny Ardant - avec
laquelle il s'est marié en 1981 et eu une fille,
Joséphine, le 28/09/83 - (La Femme d'à-côté,
Vivement dimanche !).
La carrière de François Truffaut joue également
avec le principe de l'alternance. A un film lourd (Les Deux
Anglaises et le continent) succédera un divertissement
(Une belle fille comme moi) ; à un film commercialement
risqué (L'Enfant sauvage ou La Chambre verte) fera
suite une entreprise a priori plus évidente pour
le public (Domicile conjugal ou L'Amour en fuite). Hitchcockien
de coeur, Truffaut adoptera le même mode de fonctionnement
que son cinéaste de chevet, au point d'apparaître
dans certains de ses films et, à partir de L'Enfant
sauvage, d'en devenir l'acteur principal. Dans les films
qui lui tiennent peut-être le plus à coeur
(L'Enfant sauvage, La Nuit américaine, La Chambre
verte), François Truffaut n'a pu se résoudre
à passer par un interpète et s'est confié
le rôle principal.
Rétrospectivement, et malgré sa diversité,
toute sa carrière nous paraît extrêmement
cohérente. Il est en tout cas peu de projets qu'il
n'aura pas réussi, à force de ténécité,
grâce également à l'autonomie que lui
donnait sa structure de production, à mener à
terme. Toujours prêt à monter en première
ligne dans l'"intérêt supérieur
du cinéma français", fort de ses succès
et de sa situation, de fait, de "patron", il ne
lui manquera que le temps. Après la crise personnelle
qui suit, en 1975, L'Histoire d'Adèle H., il ne résistera
que quelques années à la maladie qui l'emportera
le 21 octobre 1984, un an après la naissance de sa
dernière fille, Joséphine. Il aimait les enfants,
les femmes et le cinéma. Il avait cinquante-deux
ans.