1970 : expériences militantes
et symptômes de crise
Où l'on voit les premiers signes importants d'une crise
qui couve depuis le début des années 60 et dont
le cinéma français n'est pas encore sorti. Avec
le développement de la télévision, l'accroissement
de son rôle de co-producteur dans le financement des films,
les structures ancestrales du cinéma sont touchées
de plein fouet. On assiste à une diminution sensible
du nombre de salles de quartiers, à la disparition de
nombreux exploitants indépendants et donc à une
concentration du parc de salles. De même, les ciné-clubs,
qui avaient fleuri dès la Libération, souffrent
de désaffection. Parallèlement, le marché
des vidéo-cassettes est en plein essor et va continuer
à se développer dans la décennie suivante.
Les structures de production se modifient également.
UGC est privatisée et rachetée par la fédération
française des cinémas en 1971. Une troisième
chaîne apparaît en 1972. FR3 lance, tout comme l'INA
(Institut National de l'Audiovisuel), une production d'oeuvres
originales qui permet l'éclosion de jeunes metteurs en
scène. On assiste donc à un recentrage qui n'est
encore qu'une esquisse de ce qu'on appellera, quinze ans plus
tard, le paysage audiovisuel français (PAF). On croit
encore alors à l'utopie d'une télévision
telle que la rêvait Roberto Rossellini, outil de démocratie,
venant soutenir le nouveau cinéma.
Les années 70 sont aussi les années
politiques du cinéma, marquées par les mouvements
féministes, militants, les coopératives de tournage
la défense des autonomies, des séparatistes, des
grandes luttes ouvrières de l'époque. Jean-Luc
Godard rejoint "Dziga Vertov" (du nom d'un documentariste
de la révolution russe) pour éloborer un cinéma
politique nouveau. Il réalise "Vent d'est"
avec Chris Marker, en 1969 et "Pravda", en 1970. Le
féminisme trouve ses porte-parole auprès du grand
public avec Agnès Varda et Yannick Bellon. Ce cinéma
est en prise directe avec la réalité sociale.
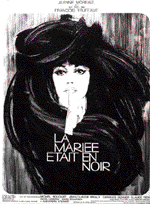
Sur le plan technique, le son connaît
d'importantes transformations avec l'utilisation du quartz (permettant
le contrôle de la synchronisation de la caméra
et du magnétophone), l'utilisation de micros émetteurs
et l'application du son Dolby au cinéma (1975).
De nouveaux réalisateurs apparaissent
dans la lignée de la Nouvelle Vague (Jean Eustache, Jacques
Doillon, André Téchiné...) ou de façon
plus indépendante voire réactive (Bertrand Tavernier,
Claude Sautet, Michel Deville...), chantres d'une nouvelle "qualité
française". Mais tous ont en commun une forte culture
cinéphilique. Les années 80 s'annoncent déjà
avec une dispersion esthétique qui confirme une marginalisation
du cinéma comme son imprégnation par d'autres
formes d'images venues de la télévision, du clip
ou de la publicité. La création des Césars,
en 1976, marque aussi le grand retour des "professionnels
de la profession", comme dirait Godard, et la fin des utopies
du cinéma français.

