1930 : les réalismes
L'arrivée du parlant a des effets considérables.
D'une part, la restitution du son oblige à uniformiser
la vitesse de défilement des films (24 images/seconde),
ce qui améliore la qualité de la projection. D'autre
part, l'enregistrement du son impose de nouvelles contraintes.
"Rien ne m'amuse davantage, déclare Méliès
en 1935, que les efforts des opérateurs actuels qui sont
forcés, à cause de l'immobilité des acteurs
engendrée par le dialogue, de faire visiter toute la
pièce aux spectateurs". Les sujets changent, car
les dialogues permettent d'aborder la psychologie des personnages
et le jeu des acteurs doit s'adapter. Enfin doté du pouvoir
de représenter la société dans ses subtilités,
le cinéma de cette période reflète les
états d'âme du peuple français à
travers le réalisme poétique et le réalisme
noir d'avant-guerre. Des cinéastes, auparavant liés,
ont rejeté son formalisme mais conservé sa rigueur
artistique ; ils créent des chefs d'oeuvre : Jean Vigo
film "L'Atalante" (1934), Jean Renoir tourne "La
Chienne" (1931), "Toni" (1934), "La Grande
Illusion" (1937), "La Règle du jeu" (1939).
Jean Grémillon réalise "Dainah la métisse"
(1931), "L'Etrange Monsieur Victor" (1938), "Remorques"
(1939-1941). Le réalisme poétique appraît
sous l'influence de la littérature populaire (Pierre
Mac Orlan, Francis Carco) et de l'esthétique expressioniste,
révélée par les chefs opérateurs
allemands comme Eugen Schüffman.
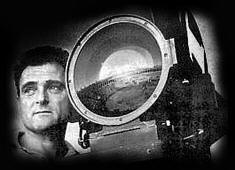
Les récits pessimistes racontent les destinées
tragiques de héros populaires dont Jean Gabin est la
parfaite incarnation. La lumière en clair obscur, l'artifice
des décors, la verve des répliques et du jeu donnent
un style lyrique prononcé. René Clair ("Sous
les toits de Paris", 1930), Pierre Chenal ("L'Homme
de nulle part", 1936), Julien Duvivier ("Pépé
le Moko", 1937), et Marcel Carné ("Quai des
brumes" et "Hôtel du Nord", 1938) en sont
les maîtres incontestés. Le Front populaire inspire
deux films en 1936 : "La vie est à nous", de
Jean Renoir et "La belle Equipe", de Julien Duvivier,
qui reflètent bien l'euphorie du moment. La même
année, deux grands écrivains du théâtre,
séduits par le parlant, réalisent des oeuvres
majeures : "Le Roman d'un tricheur", de Sacha Guitry
et "César", de Marcel Pagnol, au naturalisme
novateur.
Cette période se caractérise
par son unité et une parenté esthétique
entre les différentes formes de réalisme, qui
rattache les unes aux autres les oeuvres les plus importantes
de cette décennie. Malgré cette richesse, la production
est en crise : Pathé, après s'être associé
avec les frères Natan, fait faillite en 1939. Gaumont,
qui dépose son bilan en 1938, est renfloué par
les banques. La production s'émiette en de multiples
sociétés.
Les années 30 sont aussi celles d'une
prise de conscience, encore très minoritaire, du problème
de la conservation des films : Georges Franju et Henri Langlois
créent la Cinémathèque française
en 1936.

